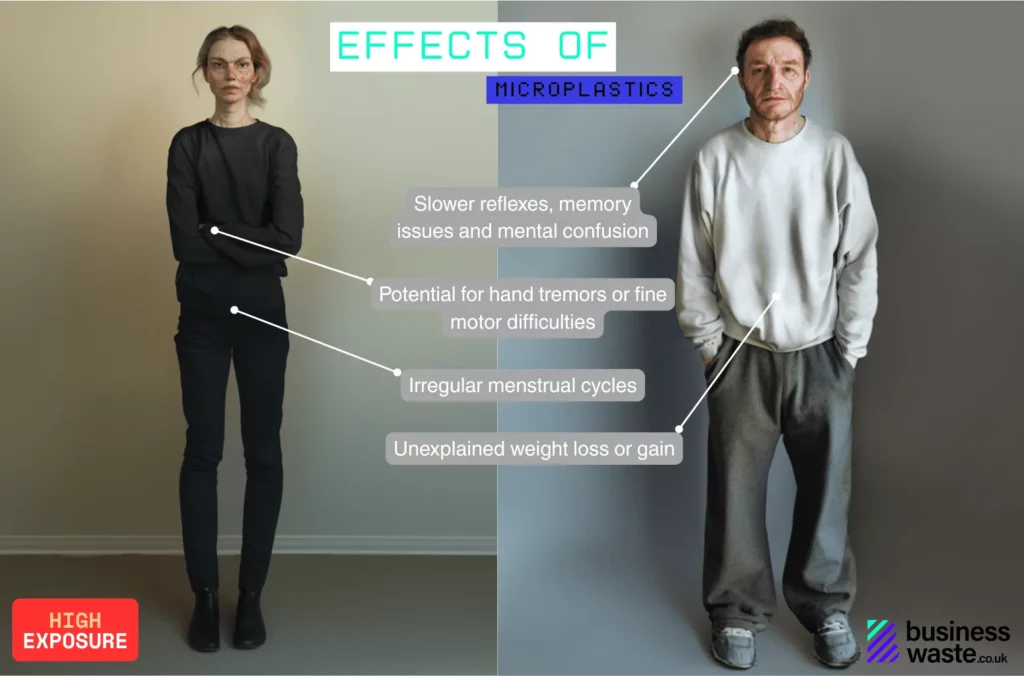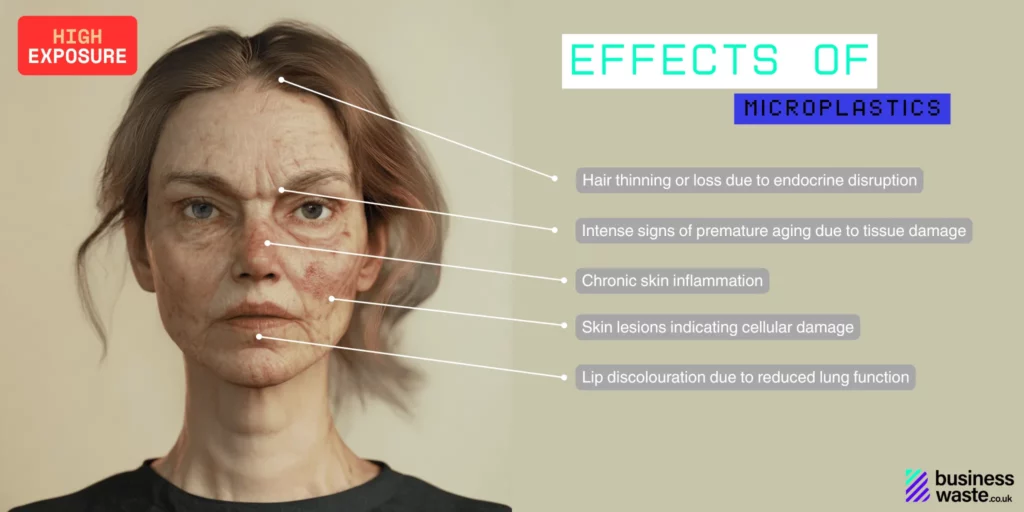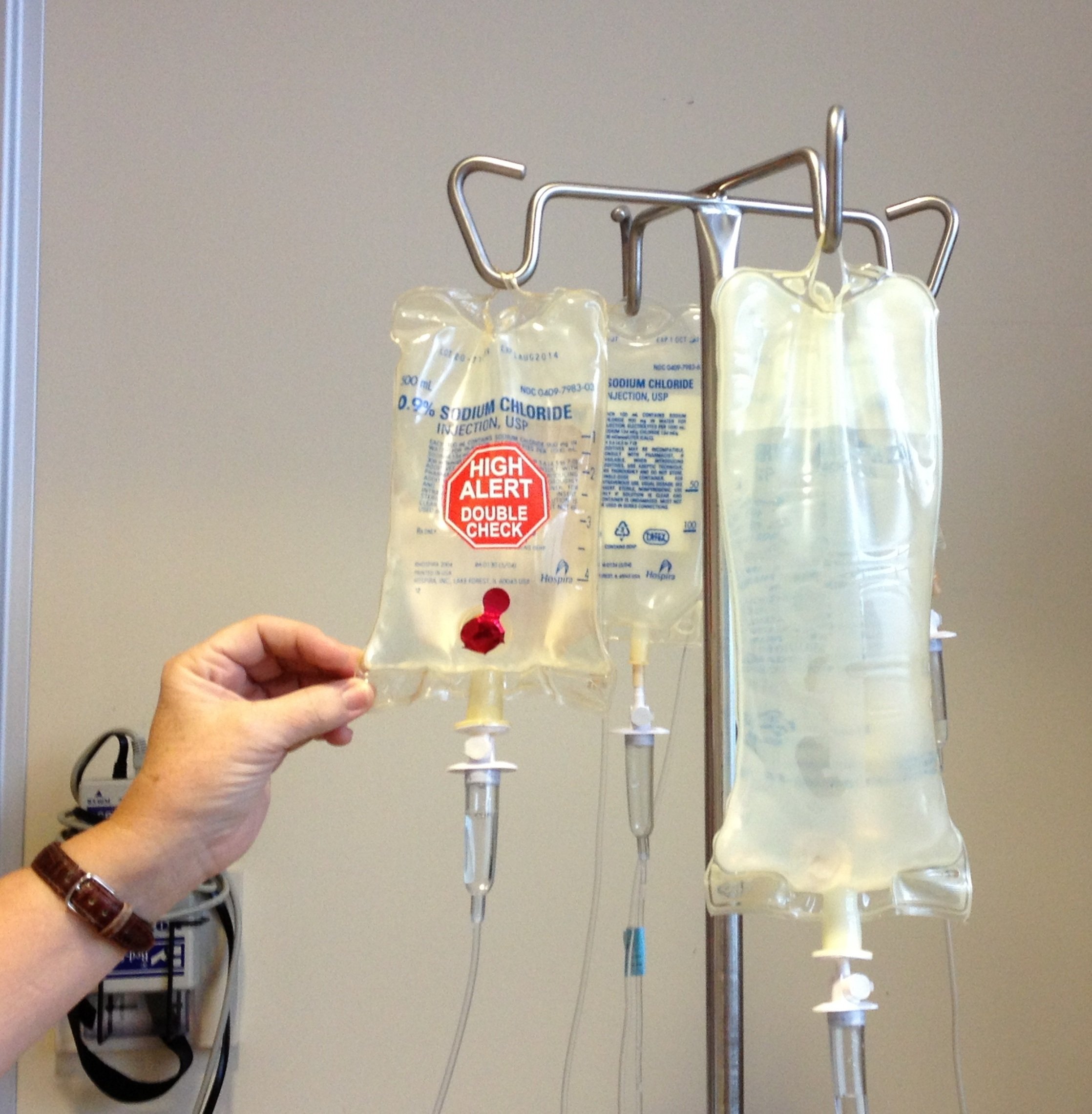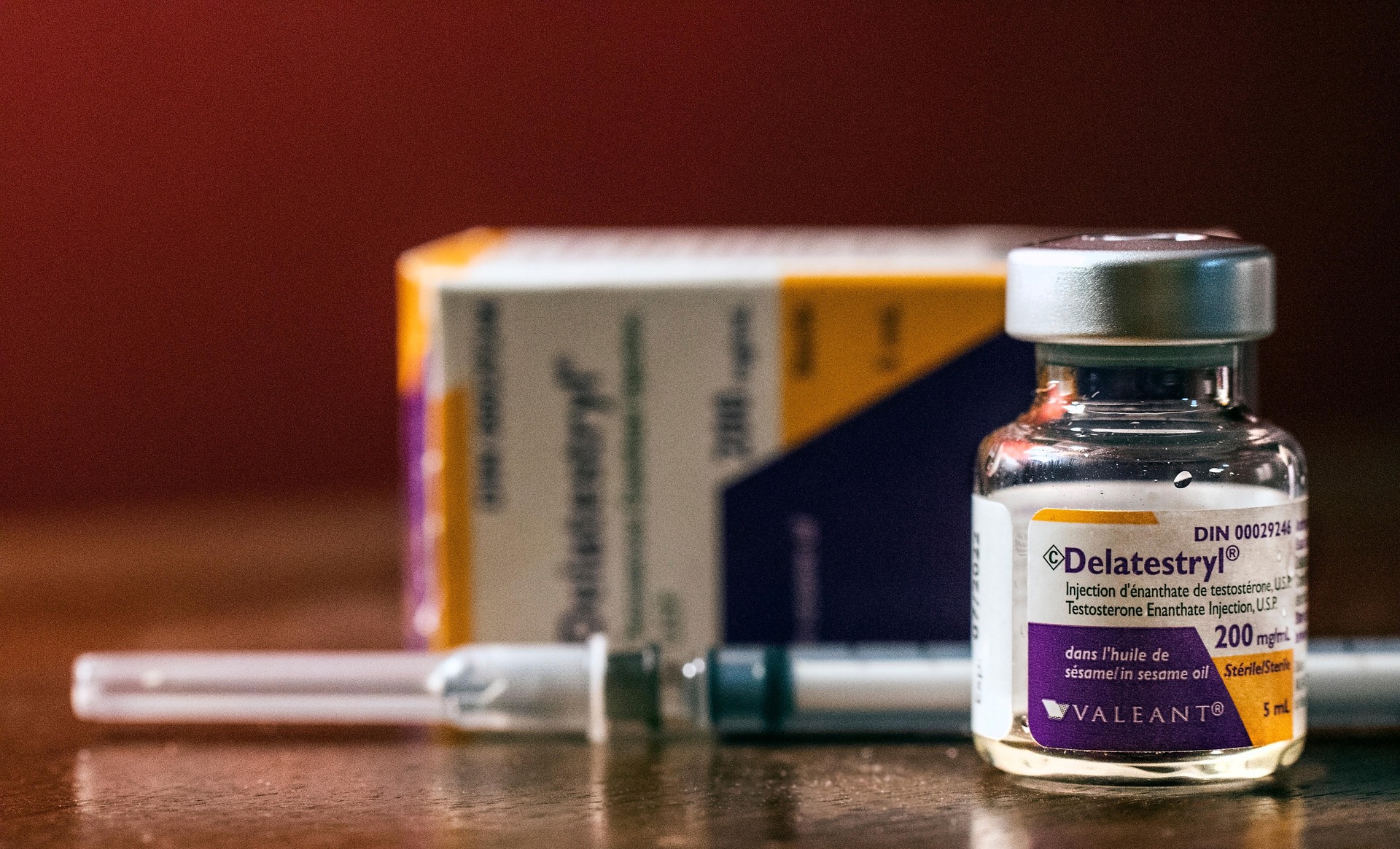Le laboratoire pharmaceutique américain Eli Lilly vient de publier les résultats d’une première étude clinique de la première pilule de type GLP-1. Et les conclusions sont plus qu’encourageantes : ce traitement serait aussi efficace que les solutions injectables pour lutter contre l’obésité et le diabète de type 2.
Confronté à l’usage détourné de l’un de ses traitements contre l’obésité, l’Ozempic, le laboratoire danois Novo Nordisk a réagi en commercialisant un médicament spécialement destiné à lutter contre l’obésité, le Wegovy. Mise sur le marché en 2021 aux États-Unis, cette formule injectable est désormais largement plébiscitée. D’autant que plusieurs études ont montré des effets positifs sur la perte de poids, réduisant ainsi le risque de crise cardiaque ou d’AVC chez les personnes obèses ou en surpoids.
Seulement, le fait que le médicament soit sous forme injectable engendre un coût exorbitant, implique des conditions de conservation strictes et peut repousser certaines personnes. Alors, en mars l’année dernière, Novo Nordisk avait annoncé lancer des études pour créer une nouvelle formule sous forme de pilule. Mais le géant danois a été rattrapé par le groupe américain Eli Lilly – dont la majorité des usines de production sont situées en France.
Baisse de la glycémie et perte de poids
Le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly a développé une pilule de type GLP-1 (comme celle développée par leur concurrent) à prendre au quotidien. L’Américain s’appuie sur une petite molécule capable d’imiter l’hormone intestinale qui stimule la sécrétion d’insuline et procure une sensation de satiété, la GLP-1, l’orforglipron (or-for-GLIP-ron).
Et selon les résultats du premier essai clinique du laboratoire, publiés mi-avril, l’orforglipron serait aussi efficace pour réduire la glycémie et favoriser la perte de poids chez les personnes atteintes de diabète de type 2 que les solutions injectables leaders sur le marché. Pour 65 % des 559 personnes ayant pris cette nouvelle pilule dans le cadre de cette étude, leur glycémie est ainsi revenue à la normale. Et le laboratoire a observé une perte de poids moyenne de 7,3 kg en 40 semaines (soit en 9 mois) – soit le même résultat clinique qu’avec le Wegovy, mais un peu en dessous de son principal concurrent, le Mounjaro.
Quant aux effets secondaires, ils sont similaires à ceux des médicaments injectables contre l’obésité, à savoir diarrhée, indigestion, constipation, nausées et vomissements.
Vers une commercialisation en fin d’année
Fort de ces résultats, Eli Lilly a indiqué qu’il demanderait l’autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) plus tard cette année pour commercialiser l’orforglipron contre l’obésité et début 2026 pour le diabète. Une annonce qui a fait bondir l’action du géant américain et qui prouve, une nouvelle fois, que le marché de la lutte contre l’obésité n’a pas fini de croître. D’autant que dans les décennies à venir, plus de 700 millions de personnes seront atteintes de diabète de type 2 dans le monde et plus d’un milliard seront obèses.
À noter que ces médicaments ne sont pas sans risques. Le laboratoire pharmaceutique Pfizer a d’ailleurs arrêté ses recherches pour développer une pilule de type GLP-1 après qu’un participant à son essai clinique à développer une « lésion hépatique potentiellement induite par le médicament ».